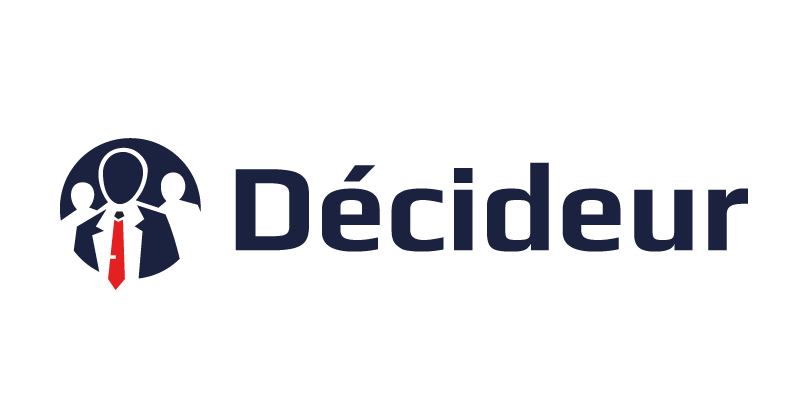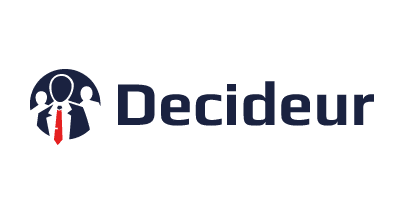5 000 fermes disparaissent chaque année en France, mais le pays demeure le grenier de l’Europe. Cette contradiction n’est pas un hasard : elle incarne la double tension qui travaille le secteur agricole, entre puissance de production et fragilité structurelle.
La France conserve sa place de locomotive agricole européenne, malgré une chute spectaculaire du nombre d’exploitations depuis quatre décennies. Plus de la moitié du territoire reste consacré à l’agriculture, mais un petit cinquième des exploitations concentre la quasi-totalité de la production. Plus frappant encore : cette concentration s’est accélérée. Derrière la façade de la diversité, un paysage agricole profondément transformé se dessine.
Les règles environnementales dictées par la PAC se conjuguent à une dépendance de plus en plus forte aux importations pour certains produits. Les agriculteurs, eux, voient leur revenu stagner sous la moyenne nationale, alors que la profession vieillit et que le renouvellement des actifs devient un défi quotidien.
Comment l’agriculture française a évolué : repères historiques et chiffres clés
Impossible de comprendre la France sans ses champs, ses élevages, ses vignobles. Pourtant, l’agriculture n’a jamais cessé de changer de visage. Les années 1960 ont marqué un tournant : on passe du modèle familial à des exploitations de plus en plus vastes, poussées par la spécialisation et la mécanisation. Aujourd’hui, la surface agricole utile (SAU) tutoie les 28 millions d’hectares, soit davantage que la superficie de nombreux pays européens réunis. Autre indicateur révélateur : la taille des exploitations a doublé en trente ans, franchissant la barre des 69 hectares en moyenne.
Mais derrière ces chiffres, une réalité s’impose : le nombre d’exploitations s’est effondré. De 1,6 million dans les années 1970, il n’en reste plus que 389 000 en 2020. Cette concentration a pour effet de confier la majorité de la production à un nombre restreint d’acteurs, dotés de moyens considérables.
Pour mieux cerner les spécificités du modèle agricole français, voici les grandes lignes à retenir :
- Les cultures dominantes : blé, maïs, orge occupent la première place, suivis de l’élevage (bovins, porcins, ovins), de la viticulture et du maraîchage.
- Répartition de la production : la production végétale pèse pour 55 % de la valeur totale, l’élevage pour 45 %.
- Poids des exportations : près de 62 milliards d’euros en 2022, avec le blé, les produits laitiers et les vins en têtes d’affiche.
La politique agricole commune (PAC), lancée en 1962, a fixé le cap pour toute la filière, conditionnant les aides publiques aux orientations européennes. Si la France affiche toujours une balance commerciale agricole positive, ce succès cache une dépendance croissante à certaines importations, notamment pour les fruits et légumes. Entre les aléas des marchés mondiaux, la montée des exigences réglementaires et l’évolution des habitudes alimentaires, l’agriculture française avance sur une ligne de crête.
Quels sont les grands types d’activités agricoles en France aujourd’hui ?
Difficile de parler d’agriculture française sans évoquer sa mosaïque de productions. Le territoire se découpe en trois grands pôles : grandes cultures, élevage, et cultures spécialisées.
- Les grandes cultures, à commencer par le blé, l’orge, le maïs et le colza, couvrent plus de la moitié des terres, principalement dans le Bassin parisien et le Sud-Ouest. En 2022, la France a récolté plus de 45 millions de tonnes de blé, s’imposant comme premier producteur européen.
- L’élevage reste solidement ancré dans l’Ouest et le Centre : bovins pour la viande et le lait, porcins en Bretagne, ovins dans le Massif central. Ces productions mobilisent près de 40 % des exploitations, chacune avec ses spécificités régionales.
- Les cultures spécialisées regroupent la viticulture, le maraîchage, l’arboriculture et l’horticulture. Les vignobles s’étendent sur près de 800 000 hectares et la France rivalise chaque année avec l’Italie pour garder son rang de premier exportateur mondial de vin. Fruits et légumes se concentrent autour de la Méditerranée, dans le Val de Loire et en Bretagne.
L’agriculture biologique gagne du terrain : 2,8 millions d’hectares certifiés en 2022, soit plus de 10 % de la SAU. Les pratiques agroécologiques progressent aussi, de l’implantation de couverts végétaux à la réduction des intrants. Même si l’agriculture conventionnelle domine encore, la dynamique vers des modes de production plus responsables s’accélère, portée à la fois par les politiques publiques et l’appétit des consommateurs pour des produits plus vertueux.
Impacts environnementaux et défis sociaux : la réalité du terrain
Le poids de l’agriculture sur l’environnement saute aux yeux dans chaque rapport, chaque diagnostic de terrain. Près de 20 % des émissions nationales de gaz à effet de serre proviennent du secteur, principalement à cause de l’élevage et de l’usage massif d’intrants. Malgré le lancement du plan Ecophyto en 2008, les produits phytosanitaires représentent encore 62 000 tonnes de substances actives vendues en 2022. L’état des sols et des eaux en paie le prix, avec des nappes phréatiques fragilisées, notamment en Bretagne et dans le bassin Adour-Garonne, face aux nitrates et aux pesticides.
La biodiversité recule, les populations d’insectes pollinisateurs et d’oiseaux des plaines dégringolent. Le climat, lui, impose de nouvelles contraintes : sécheresses à répétition, inondations soudaines, gels tardifs, pression sur la ressource en eau. Modifier les pratiques agricoles devient urgent, mais entre les impératifs économiques et la structure des exploitations, la marche est haute.
Côté social, le tissu agricole s’effrite. Moins d’exploitations, moins d’actifs agricoles : environ 390 000 exploitations en 2020 contre 1,1 million en 1970. Les fermes s’agrandissent, mais la main-d’œuvre s’amenuise. Les conditions de travail, la rémunération basse et l’isolement alimentent le malaise. Le métier attire moins, tandis que la société exige toujours davantage de durabilité et de qualité. L’équation est redoutable.
Quelles solutions pour répondre à la crise agricole et préparer l’avenir ?
Changer de cap ne se résume pas à un slogan. La transition agroécologique s’impose, repensant l’ensemble du système : moins d’intrants chimiques, plus de diversité dans les cultures, priorité aux pratiques respectueuses des sols et de l’eau. La PAC, via les éco-régimes et le plan stratégique national, oriente désormais ses aides vers ces modes de production. Mais sur le terrain, la bascule reste inégale. La certification HVE et la conversion au bio progressent, sans combler pour l’instant les besoins de transformation du secteur.
La technologie offre des solutions concrètes : l’agriculture de précision affine les apports en eau et en engrais, limitant l’impact sur l’environnement tout en maintenant les rendements. Capteurs, télédétection, robots : ces outils se diffusent, mais restent souvent inaccessibles aux plus petites exploitations, creusant parfois l’écart entre agriculteurs.
Les circuits courts et la relocalisation de la production apportent une réponse à la volatilité des marchés mondiaux et à la demande croissante pour des produits locaux. Les dispositifs du plan France 2030 encouragent cette mutation, en soutenant les filières locales et l’innovation. Les projets collectifs, coopératives, plateformes logistiques partagées, se multiplient, mais la question de l’attractivité des métiers agricoles reste entière.
Quelques pistes structurantes se dessinent :
- La transmission des exploitations devient une priorité pour assurer la relève et préserver la diversité des modes de production.
- Adapter les formations et repenser les modèles économiques s’avère indispensable face aux bouleversements climatiques et à la recomposition des marchés.
Ruralité vivante, fermes à taille humaine, innovations capables de réinventer le quotidien : dans les champs français, la prochaine génération d’agriculteurs s’invente dès aujourd’hui, entre incertitudes et promesses. Une chose est sûre : l’agriculture ne se contentera jamais de rester immobile.