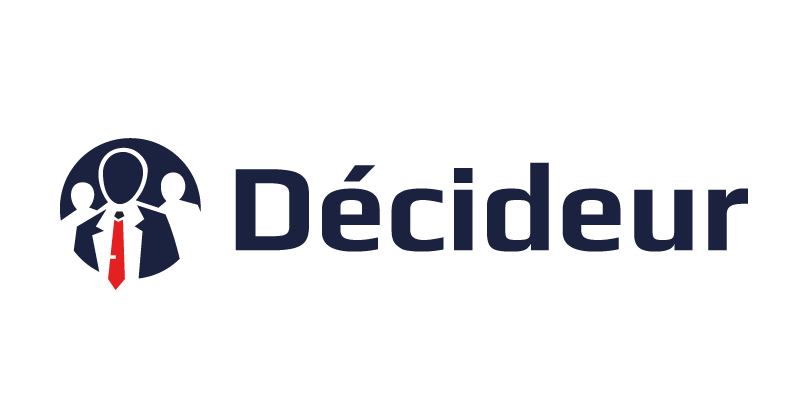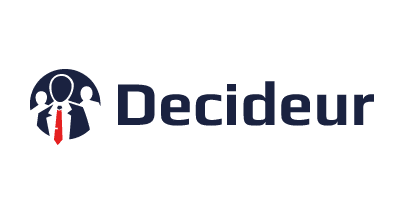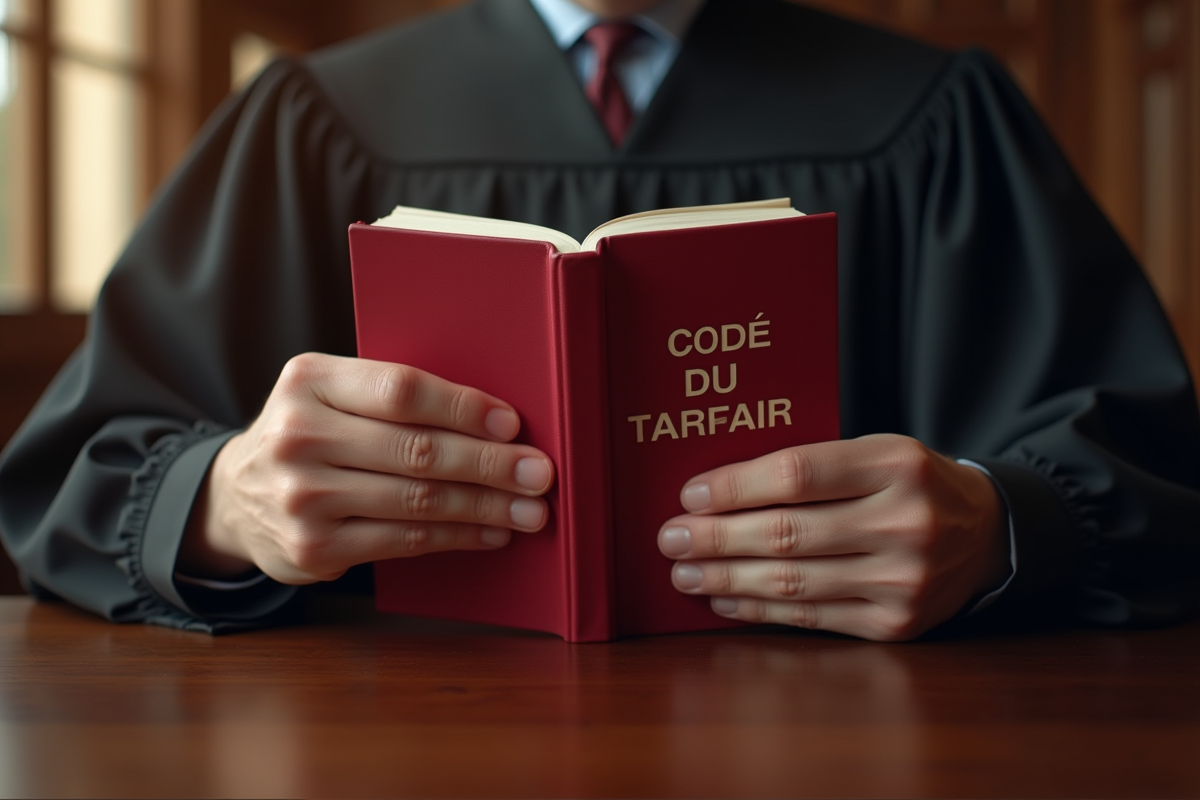Le 28 décembre 1910, la France adopte officiellement le Code du travail. Ce recueil, loin d’être figé, subit depuis plus d’un siècle de multiples remaniements, abrogeant certaines règles et en instaurant de nouvelles. La rédaction initiale ne résulte pas d’un seul auteur, mais d’un long processus législatif impliquant plusieurs commissions et ministères.
De la première réglementation sur le temps de travail aux grandes réformes des années 1980, chaque étape reflète les tensions sociales et économiques du moment. L’évolution du Code illustre la manière dont l’État arbitre entre protection des salariés et exigences du monde économique.
Aux origines du droit du travail : une réponse aux bouleversements sociaux
Le droit du travail prend racine dans les bouleversements causés par la révolution industrielle. À la fin du XIXe siècle, la France s’urbanise à marche forcée, les ateliers s’agrandissent, et la condition ouvrière s’effrite. Les horaires s’allongent, les enfants s’épuisent dans les usines. En 1841, une première loi tente de freiner l’exploitation des plus jeunes : interdiction d’embaucher avant huit ans, limitation à huit heures par jour pour les huit-douze ans. Sur le papier, la rupture est nette. Dans les faits, l’application reste fragile : sans inspection du travail, le contrôle vacille.
Le livret ouvrier, mis en place sous l’Empire, suit à la trace chaque salarié et surveille ses mouvements. Les conseils de prud’hommes, nés en 1806, tranchent les litiges, mais l’ensemble demeure dispersé, faiblement articulé. Jusqu’ici, la relation de travail s’inspire du Code civil, à travers le louage de services et le louage d’ouvrage, sans véritable reconnaissance de droits collectifs. Tant que la grève reste un délit, il faut attendre 1864 pour que cela change, et que les syndicats patientent jusqu’à la loi Waldeck-Rousseau de 1884, les salariés avancent à découvert.
Quelques repères illustrent la progression de ce cadre légal :
- 1841 : adoption de la première loi encadrant le travail des enfants en France
- 1848 : la révolution met la question sociale sur le devant de la scène politique
- 1884 : légitimation des syndicats professionnels
Le droit du travail s’est donc construit par petites touches, souvent sous la pression des mouvements sociaux. Plus les inégalités liées au nouvel ordre industriel se manifestent, plus l’État intervient pour corriger le tir. La protection des enfants et des adolescentes au travail devient alors le terrain d’expérimentation de l’intervention publique dans l’univers productif.
Qui sont les auteurs du Code du travail et comment s’est-il construit ?
Le Code du travail ne surgit pas sous la plume d’un seul auteur. Il résulte d’une génération de juristes et de réformateurs, dont Arthur Groussier reste la figure marquante. Ce député engagé consacre des années à organiser les lois ouvrières. Dès 1896, il propose un projet de codification qui deviendra la colonne vertébrale du futur Code. Son ambition : réunir en un volume unique des textes épars, hérités de décennies de luttes et de compromis.
L’accélération survient avec la création du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale en 1906, grâce à l’initiative d’Alexandre Millerand. Ce ministère, obtenu après de longues revendications syndicales, rassemble enfin sous une même autorité toutes les questions relatives à la législation ouvrière. Deux outils majeurs l’appuient : l’office du travail, chargé de compiler les informations sociales, et le conseil supérieur du travail, où employeurs et salariés débattent et négocient.
La loi du 28 décembre 1910 institue officiellement le Code du travail. À partir de là, les règles concernant les contrats, la durée de travail, la sécurité ou la représentation collective sont clarifiées et organisées. La construction du Code s’opère couche après couche : chaque réforme ajoute sa pierre, modelant un édifice juridique en perpétuel mouvement. Ce texte reste le reflet des rapports de force et des ajustements économiques propres à chaque époque.
Pour comprendre qui a façonné ce Code, il faut citer :
- Arthur Groussier : celui qui donne la cohérence à l’ensemble
- Alexandre Millerand : moteur de la création du ministère du Travail
- Le gouvernement : garant de la structuration institutionnelle
Au final, le Code du travail français est le résultat d’un patient et long travail collectif, où juristes, politiques et partenaires sociaux se sont affrontés, alliés, et ont fini par dessiner un droit du travail à la française, en constante évolution.
Grands tournants et réformes majeures : le Code du travail à travers les époques
L’histoire du Code du travail s’écrit au gré des réformes et des crises sociales majeures. Les années 1930 sont un tournant. Porté par le Front populaire, le pays accorde enfin les congés payés et la semaine de 40 heures. Léon Blum et Maurice Thorez incarnent cette ère de progrès. Les conventions collectives prennent place dans le dialogue social et structurent les rapports entre employeurs et syndicats.
Après la guerre, la Libération voit naître la sécurité sociale et des mesures inédites pour protéger contre les accidents du travail ou les maladies professionnelles. Les années 1970 apportent un souffle nouveau avec les lois Auroux. Sous l’impulsion de François Mitterrand, la représentation collective s’enracine dans l’entreprise, le droit d’expression des salariés s’affirme, la négociation collective s’élargit.
À la fin du XXe siècle, la réduction du temps de travail redéfinit l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. La semaine de 39 heures, puis celle de 35 heures sous Martine Aubry, transforment le quotidien de millions de salariés. L’apparition du SMIC, successeur du SMIG, fixe un seuil de rémunération en dessous duquel nul ne peut descendre. Avec la loi El Khomri puis la loi Macron, les années 2000 privilégient la flexibilité et renforcent la place de l’accord d’entreprise.
Les mouvements sociaux, de la contestation des gilets jaunes à la réforme du Pôle emploi qui fusionne ANPE et Unedic, rappellent que le droit du travail reste un terrain de débat permanent. Chaque changement traduit l’équilibre difficile entre la protection sociale et les exigences d’une économie en mutation.
Ce que ces évolutions ont changé pour les droits des travailleurs
Le droit du travail a radicalement transformé la relation entre employeurs et salariés. Longtemps, le rapport de subordination laissait peu de place à la contestation. Aujourd’hui, la dépendance économique s’accompagne d’un éventail de droits structurés par le contrat de travail et les conventions collectives. Les conseils de prud’hommes ont ouvert la voie à un recours effectif en cas de litige. Désormais, le rapport de force s’équilibre, même s’il demeure fragile.
Les institutions représentatives du personnel, comités d’entreprise, délégués du personnel, CHSCT, deviennent des acteurs clés du dialogue social. Le droit syndical et le droit de grève modifient en profondeur l’organisation du travail, que ce soit sur les chaînes de montage ou dans les bureaux. La formation professionnelle, puis l’emploi formation professionnelle, offrent une protection contre l’usure des compétences et ouvrent de nouvelles perspectives professionnelles.
Les impacts concrets de ces avancées se lisent à travers plusieurs transformations majeures :
- Stabilisation du contrat de travail : la rupture abusive est contestable, toute décision de licenciement doit désormais être justifiée.
- Extension des droits collectifs : négociation, consultation, participation deviennent des pratiques courantes en entreprise.
- Reconnaissance des particularités : des dispositifs spécifiques apparaissent pour les travailleurs à domicile, cadres et ingénieurs.
Le Conseil d’État et le conseil national économique enrichissent ce droit en l’adaptant sans cesse aux réalités du terrain. La France se distingue par la densité de ses textes et l’intensité de ses contentieux sociaux. Si les tensions n’ont pas disparu, elles s’inscrivent désormais dans un cadre commun, partagé et débattu. Le Code du travail, lui, poursuit son chemin, toujours vivant, toujours contesté.